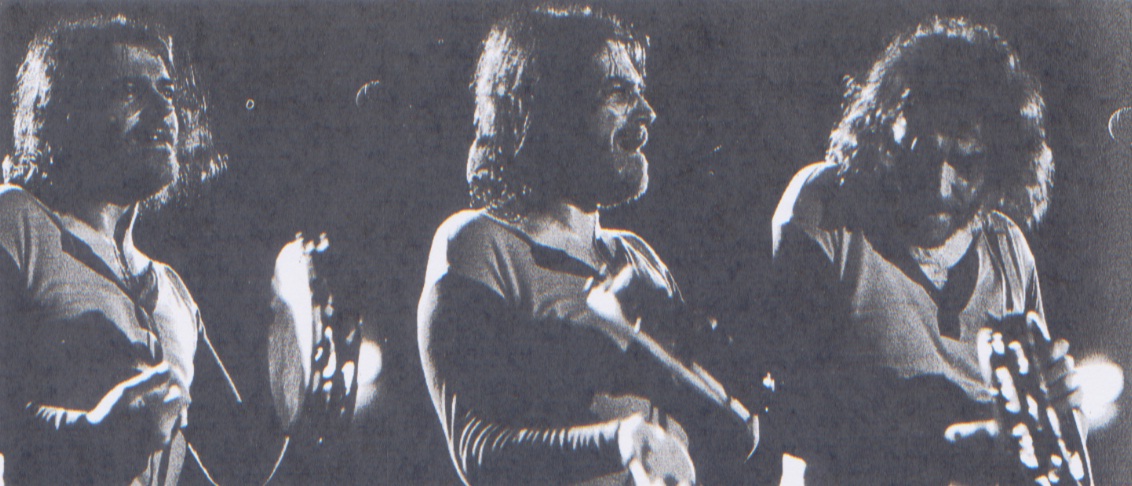|
Un Cocker gros comme ça Nous étions un peu anxieux en retrouvant Joe Cocker. Les longues cohortes de voitures, à travers les rues de Saint-Ouen, les groupes de garçons et de filles marchant rapidement, tous dans la même direction, rappelaient l’atmosphère des premiers jours des grands festivals, Wight, Woodstock. 5000 personnes convergeant vers le même endroit, dans une petite ville de banlieue, d’ordinaire tristement calme, étaient comme autant de signes annonciateurs d’une fête prochaine. La Seine roulait, grise comme d’habitude, et sous le froid ciel couvert de fin juin apparut l’Ile des Vannes, et, en son centre, la forme oblongue de son stade couvert. Là était le but de la randonnée de tous ces gens, marchant cheveux au vent et heureux de se trouver ensemble sur la même route. Tous ici pour voir et entendre Joe Cocker ce mardi 27. Joe Cocker, il aurait très bien pu faire partie de cette foule. Dans cette ville industrielle, si semblable à Sheffield, ou, 28 ans plus tôt, il était né dans une modeste famille ouvrière. Très tôt, la musique avait été son occupation favorite. A 16 ans, il plaque l’école d’apprentissage afin de s’y consacrer encore plus. La plomberie ne l’intéresse plus "Je ne voulais pas d’un boulot ou l’on bosse pendant des années et des années pour avoir droit à une montre en or à la fin". Sa petite famille ne le prend pas trop mal, et lui donne même un sérieux coup de main, avec ses moyens, pour qu’il arrive à faire quelque chose dans la voie qu’il s’est choisie.
Dès lors, il hante les petits clubs ou se produisent les artistes locaux, c’est à dore, à l’époque, les chanteurs jamaïcains de Blue-Beat, Reggae, Ska, dans les quartiers déshérités des grandes villes. Comme pas mal d’autres alors, il se glisse au fond des salles, en essayant de ne pas trop se faire remarquer, car les habitués de ce genre d’endroits n’aiment pas beaucoup le public blanc. Tout ce qui a visage pâle et a priori plus ou moins suspect dans cette atmosphère ou le racisme éclate, comme partout ailleurs. Beaucoup de musiciens font comme lui et l’idée se fait jour, progressivement, de former des groupes qui reprendraient un peu de ces rythmes. Ainsi naissent les Animals, à Newcastle, les Yardbirds, les Hollies, et bien d’autres. Ainsi Joe Cocker fait il ses premières armes, directement branché sur les musiques noires existant dans son pays. On connait la suite : un premier essai, qui rate, faute de conseils appropriés. Et puis le succès, fantastique, avec un morceau des Beatles - "With A Little Help From My Friends" - immédiatement suivi de la tornade Mad Dog & Englishmen, qui va littéralement consumer le pauvre Cocker. On se demandait comment il allait réapparaitre, après environ deux ans à l’écart de toute activité publique. On ne savait pas très bien au juste ce qui s’était passé. Leon Russel avait-il profité de la personnalité de Cocker pour se placer lui-même sur orbite ? Cherchait-il par des tenues de scène extravagantes à attirer une bonne part de l’attention sur lui ? Que deviendrait Cocker une fois "plaqué" par ses accompagnateurs ? Perdrait-il tout le bénéfice d’un formidable "backing", capable de le pousser, de l’obliger à se dépasser ? Paumé, certes, il a dû l’être lorsque sous le prétexte plus ou moins réel de se reposer il s’est retrouvé seul en Angleterre. Passé le temps nécessaire pour se "rassembler ", il ne lui restait plus qu’à envisager son retour sur un scène. Avec, au choix, un groupe relativement simple, comme celui qu’il avait à Woodstock, ou une fantasmagorie en trois dimensions et cinérama comme les Mad Dogs. Nostalgie oblige cette dernière solution fut adoptée. On récupéra Chris Stainton - viré lui aussi par Leon Russel ? - et on l’entoura d’une solide formation rythmique (deux batteries et quelques bongos), de cuivres et de choristes forts noirs et forts jolies. On baptisa le tout Chris Stainton Band, et l’on prit la route. Pour une nouvelle aventure Mad Dogs, etc…
Las, les belles histoires se renouvellent rarement sur les mêmes thèmes, et l’accueil des Etats-Unis, cette fois, plus réservé. Les musiciens faisaient un honnête boulot de professionnels, mais sans plus. L’étincelle de folie, l’incroyable culot de Russel et de ses musiciens manquaient à l’appel. Et puis peut être Denny Cordell, qui avait assuré la production de la première tournée était-il pour quelque chose dans son succès, et eut été précieux lors de la seconde. Restait Cocker : ou en était-il, dominait-il cette situation ? Nous étions, à Saint-Ouen, un peu anxieux de le savoir. Choristes magnifiques Le type avec sa guitare, c’était Gerry Lockrant. Après un bon set, généreusement accueilli, ce fut au tour de Juicy Lucy de prendre place sur la scène. Tâche difficile pour ce groupe : il avait bien entendu la charge de "chauffer" la salle avant le passage de Joe Cocker. Juicy Lucy, c’est du hard rock. Pas très juteux. Il est vrai que l’acoustique épouvantable de l’endroit, genre cloche à fromage, ne permettait guère les finesses du style. Toutes les tentatives du chanteur pour prendre la guitare sèche se soldèrent ainsi par des échecs ; mieux valait faire tourner la machine à son maximum d’intensité, jouer avec les masses sonores plutôt qu’avec les lignes mélodiques. Torrent de décibels sur nappes de kilowatts, à divers niveaux d’intensité, devaient envelopper la plupart du temps leur musique. Le résultat, s’il n’était pas particulièrement plaisant, avait au moins le mérite de secouer les sens. Le côté primaire des morceaux interprétés devant finalement faire paraitre la musique du groupe suivant comme beaucoup mieux structurée, en tout cas plus efficace. Chose sur laquelle devait plus ou moins compter Chris Stainton. L’effet joua comme prévu : lorsque les choristes – magnifiques il faut bien le dire – et l’orchestre commencèrent à jouer, ce fut comme une véritable détente, un soulagement, en même temps qu’un réel plaisir, après la tempête qui avait précédé. Le Chris Stainton Band joue un court instant seul, puis Cocker entra sur scène, de cette démarche hésitante, mi-ethylique mi-mongolienne, comme un malade en proie à de sombres affres intérieures et qui ne saurait comment s’en débarrasser. Et puis, lorsqu’il commence à chanter, tout devient clair : Cocker est de ces gens pour lesquels toute la vie tourne autour d’une passion, est faite pour la nourrir et lui redonner chaque jour des raisons de vivre et de s’exprimer. Hors de cette passion il ne peut être, en effet, qu’un malade encombré de sentiments et d’actions parasites. Seule la musique peut le délivrer, c’est à elle seule qui peut le sortir de son puits, ou il retombera, sitôt que se seront éteintes les dernières notes. Il se projette en avant, tout entier, car il ne sait que là seulement il ne risque pas de tomber. Au contraire, chaque nouvelle chanson est une façon de se relever. On finit par aimer cette attitude scénique incroyable, qui en toute autre occasion passerait pour de la débilité. On sait, en le regardant, que pour lui, ces détails ne comptent pas, qu’il a oublié depuis belle lurette à quoi peuvent faire songer ces apparences. Est-il seulement conscient dans ces moments-là que ses mains refont dans le vide les mêmes gestes que celles de Chris Stainton sur son clavier ? Mystère de la communication entre le chanteur et le musicien, chacun d’eux finissant par exister à travers l’autre ; aussi bien dans ses attitudes que dans on feeling. L’express
est lancé Le courant avec Cocker, passait donc librement, et le chanteur dut y prendre un certain plaisir, puisqu’il resta en scène pendant plus d’une heure et demie. Comme à son habitude, il fit monter la chaleur ambiante graduellement, à partir de chansons élaborées, Blues plutôt lents, reprises de thème familiers interprétés complétement différemment ("Love The One You’re With" de Steve Stills, pris sur un temps très lent, insistant sur les syllabes, les étirant pour mieux les montrer), puis, lentement, progressivement, montée avec accélération des temps sur des morceaux de plus en plus rock – "Black Eyes Lady", "Feeling Alright", encore relativement calmes, avant l’arrivée des succès de la tournée "Mad Dogs", "Delta Lady", "Honky Tonk Women", "Cry Me A River". Déjà l’express est lancé à 100 à l’heure, le public est debout et danse un peu partout, la grande folle d’antan est retrouvée, et tout le monde est embarqué pour le meilleur et pour le pire dans le circus des chiens fous. On revit les grands moments de l’épopée encore toute proche, pour un peu même on en ferait partie ; et pourquoi pas après tout ? Ce qui se passe sous cette grande coque à St Ouen, n’est-ce pas un peu la même chose qu’ont dû ressentir des milliers de gens outre-Atlantique, n’est-ce pas la même vibration qui se propage entre les musiciens et leur public, à chaque nouvelle rencontre, comme un dialogue qui se poursuivrait inlassablement, par-dessus les continents, avec pour seule et unique raison de se trouver bien ensemble pendant un moment ?
Tellement bien qu’on ne voulait plus se quitter. Dans le délire des ovations finales, Cocker revint deux fois sur scène, pour reprendre dans un crescendo de voix entremêlées – ah, ces choristes magnifiques – les medley qui sont l’apothéose du show Cocker. Ainsi "The Letter" et "Hitchcock Railway", qui marquèrent la fin de ce spectacle fantastique. Longtemps après, la foule restait là, réclamant l’improbable retour des musiciens, mise en colère, parfois, par ce qu’elle prenait pour une trop courte prestation. Cocker avait emmené ces gens si loin qu’ils n’avaient pas vu le temps passer et prenait pour un début ce qui avait été la fin d’un long et formidable concert – Alain Dister Joe l’absent
Patrice Blanc-Fracart pour Pop 2 (15 mai 1972) |